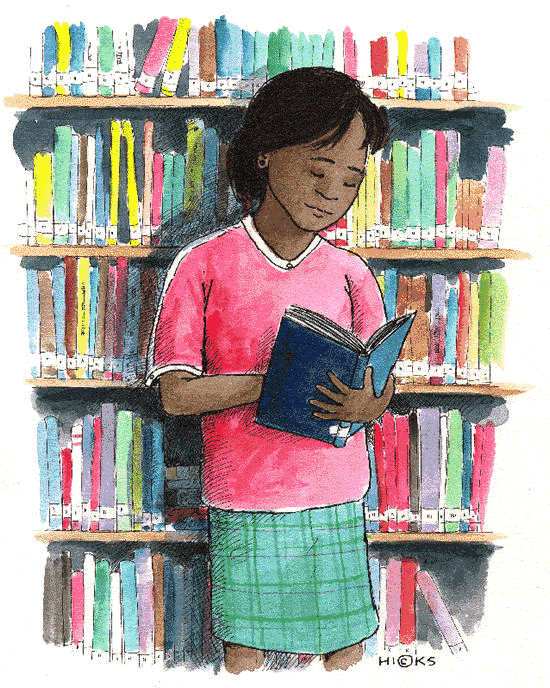
Claude Hubert-Ganiayre, Castor Poche Flammarion, 2001
«Toute lecture digne de ce nom se doit d’être absorbante et voluptueuse. Nous devons dévorer le livre que nous lisons, être captivés par lui, arrachés à nous-mêmes, emportés dans un tourbillon d’images animées, comme brassés dans un kaléidoscope. » Ainsi parle Robert Louis Stevenson, l’auteur de L’Île au trésor, du plaisir d’une lecture romanesque. Avec lui, laissons-nous entraîner dans les délicieux chemins de la fiction : pur plaisir d’être ici et ailleurs, dans les grands bois du Wisconsin, sur les routes américaines avec les enfants Tillerman, survolant la Norvège avec Nils Holgersson ou pénétrant tout simplement l’univers d’un enfant de notre âge et de notre pays, si proche et pourtant autre.
Si le romancier « promène un miroir sur une grande route » selon la formule de Stendhal, il nous renvoie aussi un miroir de nos propres sentiments parfois si confus, de nos émotions contenues, il sait nous éclairer sur nos craintes et nos doutes, donner forme à l’informe de la vie. Il nous parle, comme naguère le faisaient les contes de manière plus symbolique, des difficiles relations familiales, de l’amour, de l’amitié, de la mort aussi et le roman se fait alors roman d’initiation.
Mais il peut aussi nous faire rire, nous communiquer cet humour si indispensable pour appréhender plus sereinement le monde et nos propres difficultés.
Promenons-nous « dans les bois du roman », comme le proposait Umberto Eco. Le champ des productions romanesques est aujourd’hui immense. Il n’en a pas toujours été ainsi.
Le premier « roman » écrit pour un enfant – royal, certes ! – fut Les Aventures de Télémaque de Fénelon, roman didactique publié en 1699, inspiré des voyages d’Ulysse, destiné à enseigner morale et mythologie mais déjà roman d’aventure et d’initiation. Le XVIIIe siècle vit fleurir à côté de toute une littérature pédagogique et morale, l’adaptation de grands romans philosophiques destinés aux adultes : Les Voyages de Gulliver, de Jonathan Swift ou le Robinson Crusoé de Daniel Defoe (objet de multiples adaptations, au cours des siècles suivants).
Mais c’est le XIXè siècle qui vit vraiment naître une littérature romanesque destinée à la jeunesse. Dès 1830 Charles Desnoyers invente dans Les Mésaventures de Jean-Paul Choppart, le premier garnement révolté et fugueur. A partir de 1850, dans la bibliothèque rose, paraissent les romans de la Comtesse de Ségur, évocation d’un monde clos de l’enfance, cependant que se déploie en Angleterre la fantaisie de l’imaginaire avec Alice aux pays des merveilles de Lewis Carroll, et l’éternel enfant de James Barrie qu’est Peter Pan. La fin du siècle voit le succès du roman de l’errance et de l’orphelin avec Sans famille d’Hector Malot ainsi que les grandes aventures utopiques de Jules Vernes.
Si le XIXè siècle peut être considéré comme l’âge d’or de la littérature enfantine, dont on publie régulièrement des classiques, certains ouvrages, certains auteurs jalonnent la création romanesque française du XXè siècle destinée aux enfants, et trouvent toujours leurs lecteurs. C’est bien sûr la fable morale du Petit Prince de Saint-Exupéry, publié à New York en 1943, l’humour et la satire des Contes de Marcel Aymé ou de Gripari, les gags irrésistibles, et le langage enfantin du Petit Nicolas de Sempé et Goscinny en 1960. C’est aussi le roman de la vie quotidienne qu’est La Maison des petits bonheurs de Colette Vivier (en 1939) ou encore les premières incursions dans un véritable roman policier (loin des séries stéréotypées) avec Le Cheval sans tête de Paul Berna (en 1955).
En 1970, la Bibliothèque internationale ouvre le champ des littératures étrangères, offrant ainsi aux lecteurs une initiation à la diversité des cultures et des imaginaires. Depuis sa création en 1980, Castor Poche-Flammarion a largement contribué à cette découverte d’auteurs et de cultures du monde entier en publiant, outre de grands succès de la littérature anglaise et américaine (le merveilleux Jardin secret de Frances Hodgson Burnett, Jonathan Livingston le goéland de Richard Bach, les romans de James Houston, Betsy Byars, Marilyn Sachs ou Cynthia Voigt), des auteurs allemands comme Hans Baumann, polonais comme Wanda Chotomska (L’arbre à voile) ou espagnols comme Carmen Martin Gaite (Le petit chaperon rouge à Manhattan)…
Les frontières se sont estompées entre littérature générale et littérature de jeunesse ; des auteurs reconnus s’inscrivent dans les deux registres : Michel Tournier, Daniel Pennac, J.M.G Le Clézio, pour n’en citer que quelques-uns. Seule la poétique diffère, écrit Pennac, la thématique peut être la même.
Depuis les années quatre-vingt, la création romanesque aborde en effet des genres et des thèmes jusqu’alors « réservés ». Si l’humour et l’aventure sont toujours de mise, le roman historique évoque les conflits et les drames de notre temps ; romans policiers et romans noirs adoptent les recettes et les ressorts de la littérature adulte ; les intrigues des romans psychologiques s’inscrivent sur fond de secrets de famille et bousculent à l’occasion les tabous.
Sans doute le monde contemporain, ses angoisses et ses culpabilités se sont-ils introduits dans la fiction romanesque adressée à la jeunesse mais la qualité spécifique de ces textes réside toujours dans un certain mode d’écriture, une voix qui sait raconter, émouvoir sans troubler ni désespérer, et nous initier à la merveilleuse aventure de la lecture. Écoutons encore Stevenson : « Les mots, si le livre nous parle, doivent continuer à résonner à nos oreilles comme le tumulte des vagues sur le récif, et l’histoire repasser sous nos yeux en milliers d’images colorés. »
Flaubert (qui n’écrivait pas du tout pour les enfants) prêtait une couleur à chacun de ses romans. N’y aurait-il pas une couleur propre aux romans écrits pour la jeunesse ? A nous de la découvrir, de la savourer.
Claude Hubert-Ganiayre
